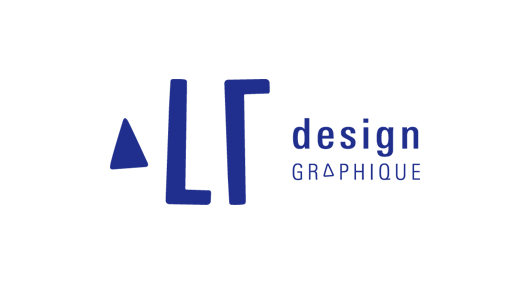Qu'est-ce qu'une "institution professionnelle"? Nous proposons ici cinq critères cumulatifs à même de caractériser ce type d'institution. Une institution professionnelle est:
• une organisation pérenne,
• associant les membres d'un ou plusieurs groupes professionnels,
• administrée en tout ou partie par des représentants desdits groupes,
• dotée de missions expressément définies,
• assurant des fonctions principalement non marchandes.
Pourquoi un générique inconnu du droit?
Cette plateforme d'information collaborative est dédiée aux syndicats professionnels, chambres consulaires, institutions ordinales, organisations interprofessionnelles agricoles, groupements de producteurs, organismes de défense et de gestion, sociétés de gestion collective, juridictions électives, opérateurs de compétence, organismes de sécurité sociale, maisons de l’emploi, associations professionnelles…
Ce groupe d'institutions comprend plus de 17500 structures, 200 catégories institutionnelles et 60 réseaux qui ont notamment en commun:
• de s'accorder sur un ensemble de principes au premier rang desquels celui de la démocratie représentative;
• de fonctionner sur un modèle institutionnel qui n'est pas plus celui des collectivités publiques que business model du secteur marchand;
• de porter l'essentiel de la décentralisation fonctionnelle en tant qu'il agit dans la plupart des domaines clés du modèle économique et social français.
De plus en plus confrontées à des problématiques communes, ces institutions ne sont pas identifiées comme un ensemble institutionnel cohérent. Nous leur proposons de se reconnaître dans la notion générique d'"institutions professionnelles" pour montrer:
• leur légitimité;
• leur capacité à structurer le débat public;
• leur contribution à l'écosystème du travail, des professions et des entreprises.
Comment reconnaître une "institution professionnelle"?
La notion d'"institution professionnelle" paraît familière mais reste aujourd'hui absente du droit français. Quels critères privilégier pour circonscrire son périmètre d'application comme on circonscrirait celui d'une qualification juridique?
Des organisations pérennes…
«Institution» renvoie étymologiquement aux actions de fonder, établir, organiser… Et de fait «Les institutions représentent dans le droit, comme dans l'histoire, la catégorie de la durée, de la continuité et du réel» (Hauriou). Les institutions professionnelles se distinguent ainsi des simples alliances, coopérations ou coordinations par une pérennité – et le plus souvent une personnalité morale – qui garantit bien leur «continuité (…) à travers une succession d'individus».
… associant les membres d'un ou plusieurs groupes professionnels…
Dites «professionnelles, multiprofessionnelles ou interprofessionnelles» (cette terminologie syndicale peut être souvent étendue aux autres catégories), les institutions professionnelles agissent en principe au nom — sinon toujours au bénéfice exclusif — de groupes professionnels, statutaires ou territoriaux circonscrits.
… administrées en tout ou partie par des représentants desdits groupes…
Les institutions professionnelles françaises n'ont pas l'autonomie de leurs homologues allemandes. Elles n'en respectent pas moins dans leur très grande majorité les principes de la démocratie représentative. Leurs organes tant délibératifs qu'exécutifs comptent ainsi des représentants des groupes professionnels désignés au suffrage universel direct ou indirect des groupes considérés. Rappelons toutefois que la puissance publique a un rôle clé dans l'administration de certains types d'institutions (directeurs, agents comptables, commissaires du Gouvernement…) au premier rang desquels ceux qui bénéficient de prérogatives de puissance publique.
… dotées de missions expressément définies…
Syndicats professionnels, institutions ordinales, chambres consulaires, juridictions spécialisées, organismes de protection sociale, organismes collecteurs, commissions paritaires… Les institutions professionnelles ont toujours une raison d'être qui s'exprime dans le soin porté à la définition de leurs missions – généralement plus précises qu'un objet social – par leurs fondateurs, le pouvoir réglementaire voire très souvent le législateur. Elles sont pour la plupart des personnes morales qualifiées soumises à des régimes juridiques précis.
… assurant des fonctions principalement non marchandes.
Le développement des institutions professionnelles n'aurait pas été concevable en France sans les lois de 1864, 1884 et 1901. Cette dernière donne une définition du «but non lucratif» comme «autre but que le partage des bénéfices» qui a été reprise dans les années 70 par la théorie anglo-saxonne de la «non-profit organisation». Ce but traduit bien l'esprit des institutions professionnelles qui ont même en commun de fournir des services la plupart du temps «non marchands» au sens de l'Insee («Une unité rend des services non marchands lorsqu'elle les fournit gratuitement ou à des prix qui ne sont pas économiquement significatifs»).