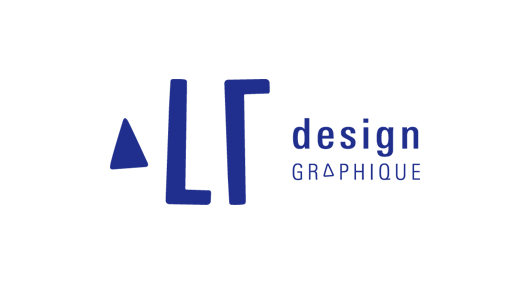— Toute l'actualité —
COVID-19 Synthèse: dialogue social au 24 avril 2020
La France se prépare au déconfinement: début de la distribution de masques grand public le 4 mai, mise en service d’applications de traçage, recommandations des autorités scientifiques sanitaires. Dans de multiples secteurs, la reprise d’activité est préparée et espérée d’urgence vu la dégradation des comptes de très nombreuses entreprises.
Veuillez vous identifier ou vous inscrire pour lire la suite...