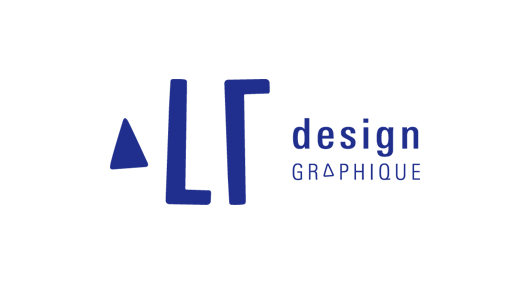L’Union des employeurs de l’économie sociale et solidaire est aujourd’hui l’une des grandes organisations interprofessionnelles d’employeurs. Sa création en 2013, marque la phase majeure d’un processus engagé au milieu du XIXe siècle est qui s’est accentué au cours des années 1970 de reconnaissance des entreprises à vocation sociale et solidaire.
Le 24 juin 2013 (Ve République) voit la naissance de l’Union des employeurs de l’économie sociale et solidaire (UDES). C'est l’aboutissement d’un processus de regroupement des acteurs de l’économie sociale en vue de conforter leur représentativité en tant qu’acteurs à part entière de l’économie obéissant cependant à un esprit et à des règles de fonctionnement spécifiques, précisées à partir de la fin des années 1970.
En contrepoint de l’État providence face à l’individualisme libéral
Le secteur de l’économie sociale et solidaire a émergé en réalité dès le milieu du XIXe siècle pour faire face aux effets de la loi le Chapelier, non sans lien avec le mouvement syndical. Il recouvre le mutualisme, les assurances et la coopération. Sous la IIIe République, il est favorisé par diverses lois autorisant les groupements d’employeurs ou de salariés (loi Ollivier, lois Waldeck-Rousseau de 1884 sur les syndicats et de 1901 sur les associations) et reconnaissant la légitimité de certaines activités (loi de 1898 sur les mutuelles, loi de 1917 sur la coopération). Après avoir été très actif, et quelque peu instrumentalisé par les pouvoirs publics durant la Guerre de 1914-1918, le mouvement connaîtra une période d’atonie, coïncidant avec la montée en puissance de l’État providence et, plus largement, d’un cantonnement des acteurs sociaux porté par l’État jacobin.
Le principe de non-lucrativité en économie de marché
Conséquemment, les différents acteurs poursuivront leur développement de manière autonome. Malgré tout, et en dépit de la multiplicité des activités qu’il recouvre, il existe des traits de culture communs, principalement celui de la non-lucrativité, sur lequel va s’opérer un nouveau rapprochement. Celui-ci est en outre facilité par l’entrée en crise, à la fois sur le plan matériel (résultats) et symbolique (technocratisme, bureaucratisation) du modèle étatiste, parallèlement au renouveau de la doxa et des politiques libérales. Les acteurs du secteur bénéficient d’une légitimité de partenaires des politiques publiques, ce qui se concrétisera aussi par la création de structures institutionnelles (délégation, institut, secrétariat d’État). Le retour au premier plan ne s’effectuera pas sans divergences, accentuées les décennies suivantes par la mondialisation, entre tenants d’une contestation du modèle économique (économie alternative et solidaire) et tenants d’un partenariat qui n’en préserve pas moins la valeur «autonomie» (économie sociale et solidaire).
En 1981, le Conseil des entreprises et groupements de l’économie sociale (Ceges) créé en 1970, édicte une charte, réactualisée en 1995, qui qualifie l’entreprise de l’économie sociale, valorise la dimension entrepreneuriale, inclus l’associatif, et un secteur d’activité porteur d’effets économiques bénéfiques. Selon la charte, les entreprises du secteur sont «dans l’économie de marché», et en tant que telles «font face aux contraintes et exploitent les opportunités de la vie économique (…) recherchent l’amélioration de leur productivité (…) s’adressent aux marchés financiers, recourent aux techniques les plus modernes». Elles se différencient néanmoins en tant qu’elles priorisent la «solidarité au service de l’homme (…), privilégient le service rendu par rapport au profit dégagé» et par leur fonctionnement «nées d’une libre initiative collective, elles appliquent la règle démocratique: “un homme, une voix”; leur éthique implique le souci de la qualité du service, de la transparence de la gestion et de la prise en compte équitable des relations avec les salariés».
De l’Usgeres à l’Udes
En 1994, deux institutions professionnelles majeures du secteur décident de se regrouper pour représenter leurs intérêts : l’Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux (Uniopss) porte, depuis 1947, la voix des associations des secteurs sanitaire, social et médico-social, engagées aux côtés des personnes vulnérables et fragiles ; le Crédit coopératif, créé en 1893, est un outil bancaire au service des associations ouvrières, puis du secteur coopératif. L’Union de syndicats et groupements d’employeurs représentatifs dans l’économie sociale (Usgeres), deviendra rapidement la principale organisation multiprofessionnelle d’employeurs de l’économie sociale. En 2002 et 2008, dans le cadre des élections prud’homales, des listes communes «Association des entreprises d’économie sociale» sont constituées entre Usgeres, Gema (Groupement des entreprises et mutuelles d’assurances, créé en 1963 par cinq mutuelles) et Unifed (Unir et Fédérer, groupant depuis 1993 des organisations d’employeurs du secteur médico-social). La structure sera notamment présidée par Gérard Deschryver puis Alain Cordesse.
Favorisée par l’habilitation à négocier avec les syndicats en même temps que rendue nécessaire par la restructuration de la représentativité syndicale engagée dans les années 2000, une nouvelle consolidation opère en 2013. L’Union de syndicats et groupements d’employeurs représentatifs de l’économie sociale (Udes) regroupe désormais l’Usgeres et le Syndicat des employeurs associatifs de l’action sociale et médico-sociale créé en 2010 (Syneas). De par sa fusion en 2016 avec la Fédération nationale des associations gestionnaires au service des personnes handicapées et des personnes fragiles (Fegapei), le Syneas est désormais rattaché à l’UDES au tire de l’entité Nexem.
Une organisation interprofessionnelle nationalement représentative
En 2018, l’organisation professionnelle d'employeurs revendique l’affiliation de 23 groupements et syndicats (associations, mutuelles, coopératives) et 16 branches et secteurs professionnels, soit encore 80 % des employeurs du secteur. L’organe souverain de l’association est l’assemblée générale, laquelle désigne un conseil d’administration (29 membres) représentatif des grands secteurs de l’économie sociale. Depuis début 2025, l’UDES est présidée par David Cluzeau, qui a ainsi succédé à Hugues Vidor, précédemment vice-président de l’Usgeres. Elle est aujourd’hui au nombre des organisations professionnelles d’employeurs représentative au niveau national et multiprofessionnel, à l’instar du Medef, de la CPME, de l’U2P, de l’Unapl, de la FNSEA.